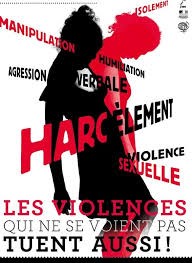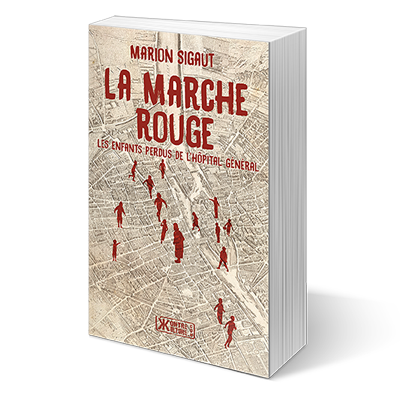Ethnies du pays de la Téranga
Le facteur ethnique joue un rôle important dans le fonctionnement des sociétés africaines.
Parmi les autres grandes catégories de différenciation sociale :
- caste,
- religion,
- classe,
l’ethnicité semble la plus opérante.
L’impact des grandes religions importées, le statut des castes ainsi que les divisions politiques entraînées par le fait colonial et sa suite, n’ont pas réussi à ébranler durablement l’unité nationale sénégalaise.
Celle-ci s’est forgée historiquement et les nombreux mariages interethniques ou l’urbanisation accélérée ont fait du Sénégal “une communauté de personnes originaires d’un même territoire, obéissant aux lois d’un même Etat”.
Le sénégal compte vingt et une ethnies.
Les groupes ethniques au Sénégal
Issus du royaume Dyolof fondé au XVIème siècle, les Wolof se dispersèrent vers le XVIème siècle. Représentant aujourd’hui 43% de la population sénégalaise, ils constituent l’ethnie dominante. Mais 80% de Sénégalais parlent le Wolof, devenu la langue principale.
Leur langue d’origine nigéro-congolaise est devenue un moyen d’expression à part entière. Majoritaires, les Wolofs constituent sans conteste l’ethnie qui joue le rôle le plus important.
Associés au colons dans le développement de l’Afrique Occidentale française et souvent usés par eux, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeux et ténir les rênes du Sénégal indépendant. Leur peuple est régi par un système de caste toujours vivace de nos jours.
Concernant leur savoir-faire, il réside principalement dans l’agriculture et plus particulièrement dans la culture d’arachide. Les Wolofs se rapprochèrent de l’islam que très tard, au XIXe siècle.
Ces deux groupes etheniques proches, partagent la même langue, le pulaar.
Ils forment à eux deux 25% de la population.
Les Toucouleurs sont les premiers à suivre la parole du prophète (et très tôt, ce fut ce qui les distingua).
Comme presque toutes les sociétes des parages, le peuple toucouleur s’organise comme un système de castes, qualifiant de façon séparées les hommes de prière, les nobles, les artisans, les pêcheurs…
Bergers nomades, les Toucouleur sont cependant de plus en plus nombreux à délaisser les conditions de vie rudes du Sahel pour s’établir en ville. Un jeune Toucouleur vivant en milieu urbain à toutes les chances d’être trilingue : il parle toucouleur à la mison, wolof avec ses amis, français à l’école.
Les Peuls, leurs origines restent mystérieuses.
Certaines hypothèses avancent qu’ils viendraient d’Afrique de l’Est, de Nubie, d’Ethiopie, voire de plus loin encore…
On les associes dés le XVe siècle à l’islam, à de grands marabouts et à l’arrivée en afrique noire des premiers éléments de l’écriture arabe.
Ils sont traditionnellement éleveurs.
Un autre groupe important (autour de 10%) mais historiquement, ils ont la particularité d’avoir été islamisés à l’époque du Mali et du Ghana. Et ensuite d’être retournés vers l’animisme, puis vers Mahomet avec la montée en puissance d’El Hadj Omar Tal.
Les Soninkés sont considèrés comme les descendants des fondateurs de l’empire du Ghana au XVIème siècle, ils cultivent le goût de la liberté et du voyage.
Contraints à l’exil, beaucoup d’entre eux sont allés en Europe, et plus particulièrement, en France, où ils constituent l’une des plus importantes communautés sénégalaises.
Ils restent profondément attachés à la religion musulmane.
Peuple que l’on ose à peine présenter, le peuple Mandingue à la musique moderne. Ce sont les descendants des guerriers musulmans qui ont fui la chute de l’Empire du Mali en se réfugiant en Gambie et en Casamance.
Aujourd’hui, ils vivent principalement dans une région à cheval entre les fleuves Sénégal et Niger (Mali, Sénégal) egalement en Gambie Guinée et en côte d’Ivoire.
Les Madingues connurent l’Islam au XIe siècle.
Souvent considéré comme un sous-groupe des Wolof, les Lébou habitent la région du Cap-Vert (0,8% de la population du Sénégal).
Légitimés par le pouvoir colonial, ils ont proclamé leur indépendance en 1831, et sont par conséquent la seule ethnie a s’être organisée en gouvernement.
Les lébous sont radicalement tournés vers la mer, gardant les cultures de mil et manioc pour les moments où le poisson se fait plus rare.
Ils parlent un dialecte wolof et sont aujourd’hui majoritairement musulmans, mais ont conservé des pratiques issues de leur religion traditionnelle.
Troisième ethnie du Sénégal après les Wolof et les Peuls (17% de la population), les Sérère auraient pour origine le Fouta-Toro qu’ils auraient quitté vers le XIIème siècle pour fuir l’islamisation instaurée par l’empire du Mali, mais aussi à cause de la sècheresse.
Aujourd’hui il habitent le centre-ouest du Sénégal, au sud de la région de Dakar jusqu’à la frontière gambienne (particulièrement dans la région du Sine Saloum), et ils vivent de la culture du mil et de l’arachide ainsi que de la pêche.
Leur mode de vie reste très marqué par l’animisme, cependant, la majorité d’entre eux ont adopté la religion chrétienne.
Sport aujourd’hui national, la lutte est d’origine sérère et nombre d’entre eux participent aux tournois de Mbapatt aux côtés des Diolas avec qui ils ont un très ancien lien de parenté.
Ethnie de la Basse-Casamance (5% de la population du Sénégal) près des régions forestières, les Diolas ont longtemps été protégés des invasions guerrières grâce à la barrière naturelle constituée par les marigots et les îles de la Casamance.
Ils sont profondément attachés à leurs terres, à bien des égards, ils sont à part. La culture du le riz, qui sert de base à leur alimentation, a survecu à toutes les pressions coloniales.
Les Diolas sont également les spécialistes de la culture de palmiers et de la récolte du vin de palme. C’est un peuple très épris de liberté qui refusa toute domination étrangère et les enrôlements de force dans tous les conflits.
Essentiellement catholiques, ils respectent aussi les valeurs ancestrales de la nature et de la vie et perpétuent les traditions animistes au travers de rites.
Les Bassaris (population 10 000 à 30 000) sont un groupe ethnique établi principalement sur les plateaux (région de collines) du Sénégal oriental et dans le nord de la Guinée.
Côté sénégalais, le pays Bassari est inclus en quasi-totalité dans le territoire du Parc national du Niokolo-Koba. Côté guinéen, certains villages ne sont accessibles qu’à pied ou en deux-roues. Cet isolement explique en partie le fort maintien des traditions au sein de la population Bassari.
Contrairement à d’autres peuples d’Afrique de l’Ouest, les Bassaris ont résisté aux razzias esclavagistes et à l’islamisation. Cette ethnie résolument de religion traditionnelle s’est réfugiée sur les contreforts montagneux du Fouta-Djalon pour échapper au harcèlement séculaire des Peuls musulmans.
Les Bassaris ont toujours été plus ou moins protégés des djihads peuls, grâce à leur isolement et au fait qu’ils vivent en altitude. Malgré cela, beaucoup ont été convertis à l’islam par des chefs peuls. D’autres sont devenus chrétiens avec les missionnaires européens au XXe siècle.
Les Bassari véhiculent auprès des occidentaux les images les plus familières du Sénégal à travers leurs cérémonies bigarrées et leurs cases aux toits de chaume.
Les Bediks forment un peuple de deux mille trois cents habitants.
Ils vivent dans les monts du Bandemba, au Sénégal oriental, entre la frontière guinéenne au sud et la courbe du fleuve Gambie au nord, dans ce pays de Kédougou éloigné de tout, dans la chaleur torride des saisons sèches, dans la moiteur terrible des étés d’hivernage.
Les Bedik sont les premiers occupants connus de cette région.
Leur histoire les fait venir du Mandin, au sud-ouest de Bamako. Animistes, ils ont dû quitter ces régions prestigieuses de Guinée du fait de l’invasion des Peuls musulmans qui à la fin du XIXe siècle les a conduits à se réfugier sur les hauteurs.
Ces blocs impressionnants de pierre, au milieu desquels les Bedik ont construit leurs villages, constituent une protection naturelle efficace. Ces pierres de dolérite qui entourent leurs maisons ont protégé jadis leurs ancêtres et accueillent encore aujourd’hui leurs sacrifices.
Ils sont catholiques, mais leur pratique est mêlée d’animisme.
Les Maures constituent un ensemble de populations au nombre de 2 millions environ, répartis du Haut Atlas jusqu’au fleuve Sénégal.
Ils sont de langue arabe et considérés issus du métissage de populations arabes bédouines, berbères et noires. L’élevage, plus ou moins nomade, constitue leur activité principale. Dans les régions les plus arides, les troupeaux sont composés de chameaux et de chèvres ; ailleurs, ils comprennent également des chevaux et parfois des bovins. Les laitages forment la base de l’alimentation.
L’artisanat est développé et les Maures ont la réputation d’être d’excellents commerçants.
Leur tenue vestimentaire est la gandourah de toile teinte, d’où le nom d’hommes bleus qui leur est parfois donné ; les femmes portent le voile.
L’organisation sociale est fondée sur la filiation en ligne paternelle. Le mariage est monogame.
La société est très hiérarchisée : au sommet viennent les marabouts et l’aristocratie, puis les hommes libres, tributaires des nobles, les affranchis (harratin), les esclaves, les artisans, groupés en castes.
Leur islamisation remonte au XVe siècle.