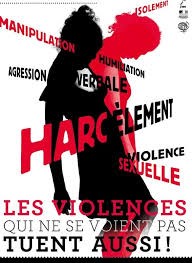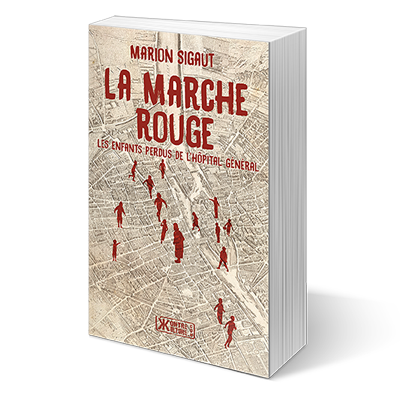Associations Humanitaires
En France, il existe près de 1.3 million d’associations
soit 20 millions de bénévoles (30 % de la population).
Leurs actions varient de l’aide médical au commerce équitable en passant par le secours aux sinistrés ou encore l’accès à la nourriture et à l’eau.
Les tranches d’âge les plus impliquées sont les 35-49 ans juste devant les plus de 70 ans.
Nous vous proposons de faire connaissance avec les dix plus grosses associations.

LA CROIX ROUGE – La plus importante
Plus importante organisation humanitaire au monde, la Croix-Rouge a été créée à la fin du 19ème siècle par Henry Dunant. Présente dans 186 pays, elle regroupe 97 millions de personnes.
La Croix-Rouge française est née en 1864. Elle dispose de 52 000 bénévoles et 17 000 salariés.
Chaque année l’action Croix-Rouge aide 1 million de personnes, permet d’en secourir 200 000, forme et initie 1 000 000 d’hommes et de femmes aux premiers secours et prépare 17 000 élèves aux métiers médico-sociaux.
L’association est présente dans 35 pays pour développer des programmes spécifiques afin d’améliorer l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire et la santé des personnes vulnérables. www.croix-rouge.fr
L’UNICEF – Tourné vers l’enfant
Créé en 1946, l’Unicef intervient dans plus de 150 pays pour assurer à chaque enfant, santé, éducation, égalité et protection.
En 2005, l’Unicef a soutenu l’ouverture d’une clinique pour enfants à Tchernihiv après la catastrophe de Tchernobyl.
Au Paraguay, elle lutte contre le travail des enfants (un enfant sur quatre doit travailler pour aider les siens à joindre les deux bouts) en mettant à leur disposition des centres où ils bénéficient de soins de santé, de bons repas, d’activités de loisirs et d’aide pour leurs devoirs.
Dans le Nord-Ouest du Népal, l’un des endroits les plus isolés de la planète, les femmes enceintes ont désormais accès à des centres d’accouchement. www.unicef.fr
AMNESTY INTERNATIONAL
– Non aux délits d’opinion
19/11/ 1960, le britannique Peter Benenson rédige un article qui paraîtra dans « The observer » : Les prisonniers oubliés.
Les premières phrases donnent le ton : ” Ouvrez votre journal n’importe quel jour de la semaine et vous trouverez venant de quelque part dans le monde une dépêche indiquant que quelqu’un a été emprisonné, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou ses croyances religieuses ont été jugées inacceptables par son gouvernement. Ils sont plusieurs millions en prison pour cela et leur nombre ne cesse de croître.”
Devant son journal le lecteur ressent un sentiment d’écoeurement et d’impuissance. Or, si ces sentiments de dégoût répandus dans le monde pouvaient être réunis en vue d’une action commune, quelque chose d’efficace pourrait être réalisé. Amnesty International était née. 3 Millions d’adhérents et de donateurs. Des dizaines de milliers de prisonniers libérés.
Elle a reçu le prix Nobel de la Paix en 1977. www.amnesty.fr

MEDECINS SANS FRONTIERES
– Créée par Bernard Kouchner
Tout a débuté au Nigeria en 1967, lors de la guerre de sécession du Biafra.
Des médecins français (dont Bernard Kouchner) recrutés par la Croix Rouge sont horrifiés par le « génocide» auquel ils assistent alors qu’ils se faisaient les «porte-voix» de la propagande des leaders sécessionnistes.
- 1971, ils décident de créer une organisation médicale d’urgence plus libre de sa parole et de ses actes.
- 1976, Médecins sans Frontières effectue sa première intervention de chirurgie de guerre. Elle apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d’exclusion des soins.
- 1999, Médecins sans Frontières reçoit le prix Nobel de la Paix. www.msf.fr
LE SECOURS CATHOLIQUE
– Contre l’exclusion sociale
Créé en 1946 par l’abbé Jean Rodhain (1900-1977).
Le but ? Lutter contre la pauvreté et l’exclusion et promouvoir la justice sociale.
En 1948, le Secours Catholique développe l’accueil familial de vacances pour permettre aux enfants touchés par la pauvreté, de partir en vacances.
Mais c’est aussi l’accompagnement des personnes à la sortie de prison, un hébergement pour les plus démunis, l’accès aux crédits personnels et au service bancaire ou encore l’aide à la création d’entreprise.
Le Secours Catholique aujourd’hui,
- c’est 365 projets, dans 71 pays, qui bénéficient à plus de 2 300 000 personnes (dont 1 500 000 en France). www.secours-catholique.org
HANDICAP INTERNATIONAL
– Aider tous les handicapés du monde
« La révolte fondatrice de Handicap International il y a 30 ans, c’était la volonté farouche d’agir pour les 6 000 amputés cambodgiens auxquels l’aide humanitaire déployée au chevet du peuple Khmer ne proposait rien !» explique Jean-Baptiste Richardier, directeur général et fondateur d’Handicap International en 1982.
Elle intervient dans 60 pays.
- Au Bénin par exemple, la fondation lutte contre la filariose (maladie causée par un ver parasite).
- Au Kenya, Handicap International intervient en faveur des réfugiés des camps de Dadaab, au nord-est du pays.
- En Ethiopie, le renforcement des services de kinésithérapie a vu le jour au sein des hôpitaux de Dire Dawa et Jijiga, a l’est du pays.
www.handicap-international.fr
LE SECOURS POPULAIRE
– Agir contre la pauvreté
En 1945, date de sa création, l’association se compose de femmes et d’hommes de cœur qui ont connu les camps de déportation, les prisons et la vie clandestine durant la seconde guerre mondiale. Leur mission :
- agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le Monde.
Cela se traduit par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentation, le vestimentaire et l’héberge-ment.
Grâce aux 800 000 bénévoles, au million de donateurs et aux 1 256 permanences d’accueil et de relais-santé, le Secours Populaire soutient près d’1,5 million de personnes sur le pan alimentaire, plus de 540 000 individus sur l’aide vestimentaire ou encore 130 000 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs.
Les missions sociales, en 2010, sont estimées à plus de 47 millions d’euros. www.secourspopulaire.fr
EMMAÜS
– Ici on t’aime
1947, l’Abbé Pierre décide de louer une grande maison à Neuilly-Plaisance, et de la transformer en auberge de jeunesse qu’il nomme Emmaüs.
Acteur historique du développement durable, on compte 191 structures Emmaüs dans 87 départements qui agissent sur le champ de la récupération en collectant à domicile ou en recevant des produits de toute nature donnés par des particuliers. Triés par des salariés en insertion, exclus jusqu’alors du monde du travail, ces produits sot revendus à prix modique. 7 000 bénévoles, 224 500 tonnes de marchandises récoltées par an, 380 millions d’euros de ressources, 15 365 logements existants et 265 000 personnes bénéficiant des accueils de jour ou des boutiques solidarités.
L’Abbé Pierre disait : « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime » www.emmaus-france.org
ARMÉE DU SALUT
– Savon, Soupe, Salut
L’Armée du Salut est fondée en 1878, en pleine révolution industrielle, par le pasteur William Booth, choqué par les foules ouvrières qui s’entassent dans les quartiers pauvres de Londres.
Son objectif : proposer des conditions de vie décente. Il s’agit d’ailleurs de l’origine de la devise : Soupe, Savon, Salut.
Implantée dans plus de 120 pays et rassemble 2.5 millions de salutistes à travers le monde.
En France 120 établissements et services d’actions sociales permettent aux plus fragiles de trouver un soutien et un accompagnement social ou spirituel.
Membre à part entière de l’Eglise Chrétienne, la fondation intervient dans la lutte contre l’exclusion, l’actions éducatives, le soutien des femmes victimes de violence ou encore la construction de résidences de retraite médicalisées.
www.armeedusalut.fr

ACTION CONTRE LA FAIM
– Pour la sécurité alimentaire
Née lors de la crise afghane en 1979, Action contre la Faim a été fondée par un groupe d’intellectuels français.
Parmi eux, Françoise Giroud, Bernard-Henry Lévy, Alfred Kastler (Prix Nobel de physique) et bien d’autres.
Cette ONG lutte contre la faim dans le monde et son action s’étend des problèmes de nutrition et de sécurité alimentaire jusqu’aux domaines de la santé et de l’accès à l’eau potable. 302 volontaires ainsi que 4 000 employés dans le monde sont en permanence sur le terrain pour sortir de la souffrance des millions de personnes touchées par la famine ou la maladie liée à un problème de malnutrition.
Elle est venue en aide a près de 6 millions de personnes dans plus de 45 pays, en 2010.
www.actioncontrelafaim.org